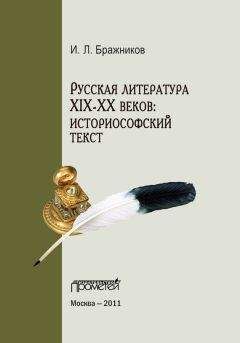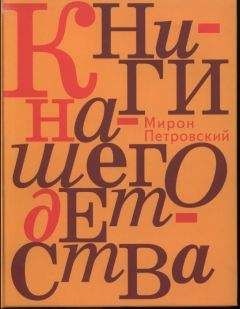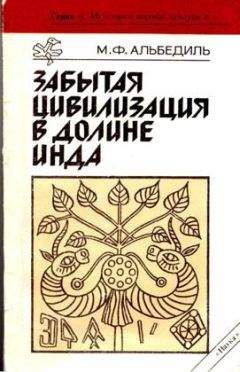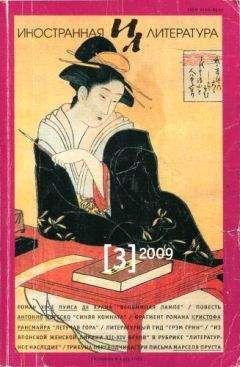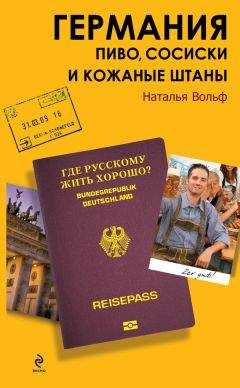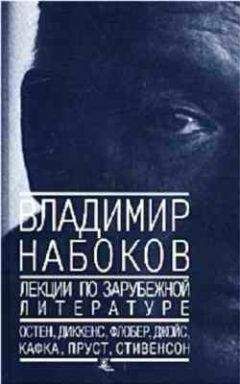Владимир Бибихин - Переписка 1992–2004

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Переписка 1992–2004"
Описание и краткое содержание "Переписка 1992–2004" читать бесплатно онлайн.
Приношение памяти: десять лет без В.В. Бибихина. Текст этой переписки существует благодаря Ольге Лебедевой. Это она соединила письма Владимира Вениаминовича, хранившиеся у меня, с моими письмами, хранившимися в их доме. Переписка продолжалась двенадцать лет, письма писались обыкновенно в летний сезон, с дачи на дачу, или во время разъездов. В городе мы обычно общались иначе. В долгих телефонных беседах обсуждали, как сказала наша общая знакомая, «все на свете и еще пару вопросов».
Публикуя письма, я делаю в них небольшие купюры, отмеченные знаком […], и заменяю некоторые имена инициалами. Другой редактуры в тексте писем нет
La question de la technique n’est pas une question facile. Non pas qu’elle impliquerait un déploiement d’enquêtes excédant les capacités que nous sommes individuellement en état de mettre en œuvre, mais tout simplement parce qu’elle demande un changement sans précédent du mode de questionnement.
Envisager ne serait‑ce qu’un changement quelconque, voilà qui ne va pas sans susciter quelque perturbation. Mais ce changement‑là, le changement du mode de questionnement, risque de bouleverser d’une manière si profonde, qu’il est prudent de commencer par s’y exercer pour ainsi dire du dehors (c’est—à-dire d’abord par des décalages formels) avant de l’entreprendre pour de bon.
À titre préparatoire, regardons le titre choisi par Heidegger lorsqu’il s’est agi de publier, en 1962, le texte du cours professé pendant le semestre d’hiver 1935/1936, et qui s’intitulait originalement: Questions fondamentales de la métaphysique.
Le livre de 1962 porte le titre: “Die Frage nach dem Ding”. Ce titre permet de vérifier ce que nous venons d’avancer. À première vue il donne à entendre que l’on s’y interroge sur ce qu’est une chose. Mais en réalité il invite à nous livrer à un exercice dont la pratique demande des qualités peu cultivées, l’exercice qui consiste à envisager face à face (si l’on ose dire) quelque chose qui ne cesse d’échapper; à savoir, dans le cas précis, le fait qu’une “chose” — ce que nous nommons “une chose”, et que les Allemands nomment “ein Ding” (les Anglais “a thing”) — il se pourrait bien, malgré toutes les découvertes techniques qui s’accumulent depuis des siècles, que nous en soyons beaucoup plus éloignés que nous ne pensons; si éloignés même, que nous ne pressentons plus guère ce que sont les choses, ce qu’elles sont, désormais, radicalement à notre insu (raison pour laquelle un malaise presque insupportable s’installe, à peine quelqu’un en vient‑il à simplement énoncer que ce que nous pensons aujourd’hui des choses nous barre l’accès à ce qu’elles sont en vérité).
Ce que sont les choses, Heidegger nous invitera plus tard à en apprendre le B, A, BA à même l’expérience la plus humble, en faisant paraître que la moindre des choses n’est vraiment que dans la mesure où, avec elle et en elle, est en cause et se rassemble le cadre entier non seulement de toutes les choses, mais de tout ce qui est.
Avant cette leçon de chose, on peut lire à la dernière page du livre publié en 1962 (dont on pourrait rendre le titre en disant Questionner après la chose):
«Nous avons dit plus haut que la question de la chose [die Dingfrage] était une question historiale; à présent nous voyons plus lisiblement à quel point il en est bien ainsi. La manière dont Kant questionne après la chose consiste à questionner après “intuitionner” et “penser”, après “l’expérience” et ses “principes”; ce qui signifie: cette question questionne après l’homme. La question: Qu’est‑ce qu’une chose? n’est autre que la question: Qui donc est l’être humain?
Mais cela n’implique pas que les choses soient de simples fabrications de l’ingéniosité humaine; tout au contraire, cela signifie: l’être humain doit être compris comme cet être qui, toujours déjà, saute d’emblée par‑delà les choses, mais de telle manière que sauter par‑delà les choses n’est possible que dans la mesure où les choses, tout en demeurant elles‑mêmes, viennent à la rencontre <de l’homme> — en ceci précisément qu’elles nous renvoient nous‑mêmes derrière nous, derrière tout ce qui, chez nous, en reste à la surface. Dans le questionnement kantien après la chose s’ouvre une dimension qui s’étend entre la chose et l’être humain, et dont l’étendue porte loin en avant par‑delà les choses, tout en portant à rebours bien derrière les êtres humains.»
Le style de Heidegger se reconnaît moins au vocabulaire qu’à la façon qu’il a de faire apparaître phénoménologiquement, par exemple: cette “dimension” dont il parle à la fin du texte que je viens de citer. Il me paraît important de souligner ce trait, parce que cela permet de saisir quelque chose qui, dans l’atmosphère asphyxiante de cloisonnement qui règne dans ce qui nous tient lieu de monde, échappe de plus en plus fatalement.
Cette dimension dont parle Heidegger — que dis‑je: cette dimension que nous voyons se déployer pour peu que nous aiguisions notre écoute en nous attachant à suivre ce qui est dit — d’autres, à leur manière à eux, l’on fait paraître. Ainsi (je n’en cite qu’un, mais quand on a l’attention avivée, on peut voir d’autres grands exemples où parallèlement vient s’exposer une manifestation comparable), ainsi, Henri Matisse, dans sa peinture, donne essor à ce qu’il nomme dans ses propos: “espace spirituel”, ou “espace cosmique”, “véritable espace plastique”, dont la spécificité consiste, dit‑il, à être un “espace vibrant”. Dans un propos rapporté par André Verdet[100], et datant de la fin de sa vie, Matisse déclare «Il y a aussi la question de l’espace vibrant.
Donner la vie à un trait, à une ligne, faire exister une forme, cela ne se résout pas dans les académies conventionnelles mais au dehors, dans la nature, à l’observation pénétrante des choses qui nous entourent.»
Dans un propos plus ancien[101] (datant de 1929), il exposait l’intention qui préside à son travail de peintre:
«Mon but est de rendre mon émotion. Cet état d’âme est créé par les objets qui m’entourent et qui réagissent en moi: depuis l’horizon jusqu’à moi‑même, y compris moi‑même. Car très souvent je me mets dans le tableau et j’ai conscience de ce qui existe derrière moi.»
Les mots ont beau n’être pas les mêmes, l’angle d’attaque des questions pointer dans des directions distinctes — une indéniable analogie d’inspiration anime le peintre et le philosophe: celle qui les oblige l’un comme l’autre à quitter l’ordre convenu de la représentation habituelle — à le quitter une fois pour toute, c’est—à-dire avec la conviction de ne jamais plus même pouvoir y revenir. Dans ce mouvement, il ne faut pas se le cacher, gît un risque considérable: perdre le contact des contemporains, ne plus du tout leur être intelligible. Non pas par souci de se singulariser en voulant à tout prix paraître “original”, mais sous une urgence entièrement autre, qui ne peut guère tomber sous le sens, puisqu’il s’agit désormais d’exister en rapport immédiat si possible à ce dont tire son origine ce que vous êtes, ce que vous faites aussi bien que le cadre entier de tout ce qui vous entoure.
Dans le cas de Heidegger, les vicissitudes de l’histoire ont encore accru ce risque, au point qu’il est facile de masquer sous l’apparence d’une candide bonne foi des critiques dont la motivation réelle est l’incapacité d’envisager ne serait‑ce que le plus infime changement des habitudes acquises.
La façon dont aujourd’hui encore, cinquante ans après que la conférence a été prononcée, on évacue communément ce que Heidegger a tenté de faire émerger concernant la technique; la légèreté avec laquelle le philistinisme intellectuel escamote son propos sous l’étouffoir qu’est la formule inepte de “technophobie” [je n’invente rien, hélas! — je me borne à citer], tout cela aurait de quoi stupéfier, si ne pouvait s’y repérer la source de ces gauchissements: la micrologie, sinon la misologie qui condamne à faire fi de tout ce qui ne se réduit pas aux schémas grâce auxquels on se meut confortablement là où il n’y a plus que des “problèmes” en attente de leur “solution”. Je ne souligne pas cette carence parce que je me laisserais emporter par un mouvement d’humeur. Rien ne doit être ici du ressort d’un simple affect. Quand il s’agit de penser, s’impose décidément dès le premier pas, d’avoir délaissé le terrain de l’opinion et des inclinations. Heidegger, face à la technique, ne s’abandonne pas à une “phobie”. Si tel était le cas, disons‑le tout net, il ne vaudrait pas la peine de nous en occuper un seul instant.
Se mettre en état de penser, demande de ceux qui l’entreprennent qu’ils mettent en œuvre une lucidité, un sang‑froid et une sobriété capables de balayer sans désemparer hors de leur horizon la masse de lieux communs, de figures de rhétorique et d’idées reçues qui forme le fonds de
fonctionnement de la pensée commune.
Si nous avons réellement l’intention de nous confronter à la tentative de penser la technique, il faut donc savoir que cela va nous demander, à nous aussi, de nous arracher aux pesanteurs de la pensée ordinaire. C’est beaucoup plus difficile à accomplir qu’à énoncer, pour la raison que nous avons tous spontanément l’inclination à penser comme pense tout le monde. C’est en chacun de nous que vit, jamais complètement surmontée, la peur par excellence, celle d’avoir à penser par soi‑même. Nous avons peur de penser autrement qu’à l’aide des instruments de l’habitude et du conformisme, parce que penser vraiment est l’une des formes les plus aiguë du risque qu’est nécessairement exister, lorsqu’exister implique qu’il faille en existant endurer sa propre finitude.
Mais pourquoi donc penser la technique? Nous voilà semble‑t — il, devant le dernier obstacle. Car si l’urgence de penser la technique vient d’ailleurs que de la pensée elle‑même — si par exemple elle tire sa motivation des inconvénients dont le développement technique finit par répandre un peu partout la sourde inquiétude, alors il y a fort à craindre que sous la rubrique “pensée de la technique” ne se trouve en réalité rien d’autre que ce dosage de réactions sociales consensuelles qui passe pour être la pensée.
La pensée véritable est rupture — comme est rupture tout ce qui a un vrai poids dans une vie humaine. Rupture par rapport à ce qui précède, mais surtout rupture relativement à tout ce qui usurpe l’apparence d’être proche — bref: rupture qui ne cesse de rompre avec l’imposture.
À propos de la question de la technique, écoutons ce que dit Jean Beaufret. Cet homme a si admirablement appris à pratiquer l’art de rompre en se dépaysant jusqu’à soi‑même, qu’il en est devenu, même en France, comme un étranger. Comment s’expliquer autrement que pour le vingtième anniversaire de sa mort, survenue le 7 août 1982, n’ait paru en France
qu’un seul hommage à Jean Beaufret?
Je tiens à saluer la présence parmi nous, ce matin, de celui qui a écrit cet hommage: Pierre Jacerme. Son texte s’intitule Martin Heidegger et Jean Beaufret/Un dialogue [“Revue philosophique”, 2002, n° 4].
Il y a presque quarante ans, le 9 septembre 1963, Jean Beaufret écrivait à Heidegger (à la veille, donc, du dixième anniversaire de la conférence):
«Je crois que je vois, encore mieux qu’à Meßkirch, l’extraordinaire difficulté de “Die Frage nach der Technik”. Car il s’agit de la question des questions, qui par‑delà Aristote, remonte jusqu’à Héraclite, dans la mesure où le caractère irrésistible de la technique, en son déploiement plénier, répond au secret lui- même, au kruvptesqai de la fuvsi", au fait en retrait que <la fuvsi" se révèle ainsi>, par quoi l’histoire tout entière de l’allégie de l’estre‑même est portée.»
La lettre ne parle pas — il faut le dire — exactement en ces termes. Jean Beaufret, qui écrit jusque là en français (sauf en mentionnant le titre “Die Frage nach der Technik” — peut—être comprenons‑nous à présent pourquoi), à partir de “jusqu’à Héraclite”, passe en effet à l’allemand, ce qui donne comme texte — écoutons‑le tel qu’il fut reçu par Heidegger:
«Je crois que je vois, encore mieux qu’à Meßkirch, l’extraordinaire difficulté de “Die Frage nach der Technik”. Car il s’agit de la question des questions, qui par‑delà Aristote, remonte jusqu’à Héraclite, insofern das Unaufhaltsame des Wesens der Technik dem Geheimnis selbst, dem kruvtesqai der fuvsi", dem verborgenen “Daß” entspricht, durch das die ganze Lichtungsgeschichte des Seyns getragen ist.»
Que se passe‑t — il avec ce changement de langue? Il n’est pas superflu de poser la question, d’autant moins que par là — avant même de nous mettre à traduire de ce qu’écrit Jean Beaufret — nous avons occasion de préciser le sens du questionnement. Il est bon, en effet, lorsque nous questionnons, de nous demander si nous questionnons sur… ou bien si nous questionnons après.?
Pourquoi Jean Beaufret passe‑t — il du français à l’allemand? N’est‑ce pas justement parce qu’il entreprend de questionner dans le sens que nous cherchons à mettre en évidence — c’est—à-dire non pas à propos de quelque chose qui serait là sous nos yeux, mais vers ce qui non seulement n’est pas là, mais ne cesse de se dérober — selon une échappée dont l’emportement seul peut frayer le passage à une approche?
La question de la technique, dit‑il, est “la question des questions”. Entendre cette formulation suivant la pente habituelle de nos compréhensions, fait simplement passer à côté de ce qu’il s’agit de penser. Car la question de la technique n’est pas Ja question auprès de laquelle toutes les autres feraient pâle figure. C’est la question des questions au sens où, en elle, viennent se résumer toutes les autres questions, dans la mesure précise où elles sont bien autre chose que des demandes d’information; c’est la question en laquelle toutes les questions philosophiques trouvent en quelque sorte leur figure emblématique.
Tâchons de voir cela le plus directement possible, c’est—à-dire au moment du changement de langue. En se mettant à écrire en allemand, Jean Beaufret introduit une rupture dont l’indication est aussi abrupte que claire. Le mot de cette rupture se trouve être la conjonction “insofern” — où s’entend le mot “fern” (“far”, *per. pevra. pro, c’est—à-dire les vecteurs les plus constants, dans nos langues, des tensions vers l’extrême lointain). Nous y reviendrons; mais pour le faire comme il faut, voyons d’abord quel est le cours de cette phrase qui, je le rappelle, commence en français.
La question de la technique, s’explique à lui‑même Jean Beaufret lisant et relisant la conférence “Die Frage nach der Technik”, est une question éminemment philosophique (et donc nullement un problème, susceptible d’être résolu anthropologiquement, sociologiquement, bref à l’aune de la science). En tant que question philosophique, cette question — où l’on est après à questionner la technique — renvoie d’abord à Aristote. Pourquoi cela? Parce que c’est lui qui définit [en 1439 b 15 de l’Éthique à Nicomaque], là où nous distinguons “art” et “artisanat”, l’unique visage de maîtrise que les Grecs nomment indifféremment: tevcnh. Il la définit comme la première modalité d’avérer, de “produire hors du retrait” — d’ajlhqeuvein comme écrit en toutes lettres Aristote. Par là, est dégagée la caractéristique formelle de toute technique: à savoir qu’elle a fondamentalement à voir avec l’histoire philosophique de la “vérité”, laquelle commence avec l’ajlhvqeia, telle que le monde hellénique en a fait à jamais nommément l’expérience.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Переписка 1992–2004"
Книги похожие на "Переписка 1992–2004" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Владимир Бибихин - Переписка 1992–2004"
Отзывы читателей о книге "Переписка 1992–2004", комментарии и мнения людей о произведении.